“eZine pour les Mutants Digitaux”, La Spirale est une adresse à connaître absolument – si ce n’est pas déjà le cas. Véritable référence des contre-cultures émergentes et cyberpunk, ce médias de plus de vingt ans a vu le jour dans les années 90, comme fanzine vidéo, lettre d’information photocopiée avant de devenir entièrement numérique en 1995.
Hommage constant aux prophètes excentriques, la Spirale promeut une géométrie centrifuge, lancée à la découverte de marges toujours plus éloignées. Son infatigable fondateur, et principal rédacteur, Laurent Courau, a, entre autre, étudié la communauté des Vampyres américains, interviewé de grands magiciens comme Peter J. Carrol ou d’authentiques cyborgs tels que Kevin Warwick.
Le Tryangle a eu le plaisir de discuter avec lui : travail, passion pour l’étrange, projets filmiques ésotérique… Rencontre.
Photographie de une par Vincent de White
Qui est Laurent Courau ?
Laurent Courau – Question rude pour démarrer, ça ne serait pas plutôt ton travail que d’assurer les présentations ? Mais je vais faire de mon mieux… (sourire)
Pour faire court, je trouve plus naturel de me définir par ce que je fais. Je réalise donc des films, jusque-là des documentaires, des vidéoclips et des reportages, et dorénavant des films de fiction. Il m’arrive aussi de publier des livres et d’écrire pour la presse. Parallèlement à ça, j’édite depuis bientôt dix-huit ans un magazine digital, La Spirale, qui se focalise sur les cultures souterraines, alternatives ou émergentes. Ces projets ont tendance à se télescoper et à se dupliquer sur plusieurs supports. Vampyres est à la fois un film documentaire produit par Avalanche Productions et un livre sorti chez Flammarion, dans la collection Pop Cultures. La Spirale a donné naissance à Mutations pop & crash culture, une première anthologie du site publiée par les éditions du Rouergue et Jacqueline Chambon, dont la suite est actuellement en préparation sur un mode un peu différent, plus « gonzo ». Et enfin, je travaille 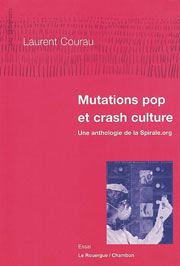 depuis quatre ans à la Demeure du Chaos avec Thierry Ehrmann et son équipe. Entre autres choses sur un long-métrage et une web-série fantastique, Les Sources Occultes, une forme de conte alchimique sombre pour adultes, que j’espère livrer entre la rentrée prochaine et le début de l’année 2015.
depuis quatre ans à la Demeure du Chaos avec Thierry Ehrmann et son équipe. Entre autres choses sur un long-métrage et une web-série fantastique, Les Sources Occultes, une forme de conte alchimique sombre pour adultes, que j’espère livrer entre la rentrée prochaine et le début de l’année 2015.
Et pour conclure cette auto-présentation imposée (sourire), je suis finalement plutôt fier d’être autodidacte. Aucune école ne m’a formé aux techniques que j’utilise. Le bon vieux « do-it-yourself », savoir faire par soi-même, ne pas attendre et dépendre des autres. Si tu as envie de réaliser un projet, mets-toi au travail et arrête d’en parler.
Pourquoi La Spirale ? Qu’est-ce que c’est, et pourquoi le choix de cette géométrie-là plutôt que le carré, le cercle ou… le triangle ?
Selon sa définition académique, la spirale est une forme géométrique dynamique. Elle symbolise les phénomènes d’expansion et de convergence. Ici, il s’agirait d’une spirale centrifuge, tournée vers l’extérieur, ouverte aux expériences et à l’inconnu ; une spirale constructive, symbole de création et d’évolution depuis l’Égypte ancienne et les premiers habitants du continent européen.
Mais avant ça, c’était surtout la dynamique graphique du symbole qui m’avait interpellé. Il me rappelait de vieilles affiches psychédéliques des 60’s et la spirale de saucisses teutonnes de la pochette de Carlos Rodriguez Is Back to L.A., le premier 45T des Cosmic Wurst, un groupe de hardcore-punk parisien de la fin des années 80, particulièrement énergique, drôle et barré, qui mélangeait la puissance caractéristique de ce style de musique à des grooves funk et disco.
Quels sont les papiers dont vous êtes le plus fier, et qui, selon vous, sont les plus pertinents à lire (ou à relire) aujourd’hui ?
Plus qu’un article isolé, c’est l’ensemble du voyage qui compte à mes yeux. Chaque article amène sa pierre à l’édifice (et souvent une suite). Quelque chose comme une dynamique d’ensemble, ça fonctionne en réseau à plusieurs niveaux, une sorte de mille-feuilles fractal interconnecté. Du coup, j’ai du mal à dissocier des éléments de la globalité de la masse d’informations et d’expériences recueillies. Mais force est de reconnaître que certains articles ont plus marqués les esprits que d’autres. Par exemple, ma première interview de Maurice G. Dantec réalisée en 1996, peu après la sortie des Racines du mal. Elle avait durée cinq ou six heures dans mon appartement de l’époque, rue d’Alésia face au centre hospitalier Sainte-Anne. Déjà un signe de reconnaissance schizotrope, pour les initiés ! (sourire)
Celle-ci avait vraiment marqué les esprits et contribué à lancer le site. Et je pourrais aussi te citer en vrac les interviews de Richard Metzger à l’époque de son site Disinformation.com, celles de l’essayiste Douglas Rushkoff et de Cindy Plenum, un ancienne gloire du porno qui s’est faite greffer une paire de seins dans le dos. Ou encore dans un autre registre, l’interview de Kevin Warwick qui travaille sur les interfaces homme-machine à l’université de Reading, puis celles de deux spécialistes de la survie David Manise et Vol West. Difficile de choisir. Je n’ai jamais pris le temps de compter, il doit y avoir à ce jour quelque chose comme 350 ou 400 interviews en ligne sur La Spirale.
Comment est venue l’idée de s’associer au magazine Chro pour une chronique mensuelle ? Les mutants aiment-ils à nouveau le papier ?
J’ai grandi avec Métal Hurlant, Actuel et Mad Movies, puis des fanzines punks américains comme Maximum Rock ‘n’ Roll et Flipside, et enfin les magazines de la cyberculture californienne du début des années 90 : Mondo 2000, bOING bOING, Future Sex, les débuts de Wired. Ce qui m’a donné le goût d’une presse différente, alternative. Lorsque les médias sont intelligents, généreux et curieux, ils possèdent la capacité d’ouvrir nos esprits, nos consciences à d’autres visions du monde. Leur potentiel est immense, tant ils conditionnent notre rapport à la « réalité ». Ce qui peut s’avérer dangereux lorsque des groupes d’intérêts privés les contrôlent, comme c’est actuellement le cas. Nous vivons déjà en pleine virtualité, avec les conditionnements que cela implique. Dans les faits qui nous préoccupent au quotidien, quelle est la part de ce que nous expérimentons nous-mêmes directement d’un côté et de l’autre de ce qui nous est rapporté par le système médiatique, en étant donc susceptible d’être manipulé ? Cette omnipotence des médias de masse justifie à mes yeux d’auto-produire un contenu et des médias différents, aussi humbles soient-ils, en proposant autre chose que la soupe consensuelle et désormais anxiogène des grands networks.
Concernant mes chroniques dans Chro, nous avions déjà collaboré en 2005 ou 2006. Époque à laquelle je m’étais vu contraint d’arrêter pour me concentrer sur la post-production de Vampyres. Et cette nouvelle mouture tombait bien, j’avais justement envie de me lancer dans un récit « gonzo » de mes aventures lorsqu’ils m’ont appelé à l’occasion d’une nouvelle formule du magazine. Ma première chronique était consacrée au Bénin, le berceau du vaudou où je me suis rendu en 2012, et au musicien écossais William Bennett qui associe la musique industrielle à des rythmes rituels africains et caribéens. Je suis vraiment fan de l’énergie et de l’inventivité africaines, un continent sur lequel tu trouves des cultures hybrides, à la fois traditionnelles et d’emblée post-modernes, que je crois appelées à jouer un rôle important au cours des prochaines années. Depuis, j’ai enchaîné sur le même format, quatre pages puis six pages, avec d’autres chroniques relatives à mes marottes, comme la Suisse, ses banques, ses escort-girls, son trading de matières premières et ses survivalistes, les arts martiaux, le free fight et l’anarchisme, ou encore le grand retour des hippies et du nomadisme à l’ère des réseaux numériques.
Pour ce qui est de mon rapport au papier, je crois surtout en l’avenir d’un outil d’information et de communication qui ne requiert aucune énergie pour fonctionner (zéro problème de recharge, de batterie ou autre), qui ne peut pas tomber en panne, qui n’intègre aucun système de traçabilité, à un format de stockage d’information qui ne change pas selon les humeurs de l’industrie du logiciel et dont le coût de fabrication reste incomparablement plus faible que celui des liseuses électroniques.
D’où vous vient cette passion pour l’étrange, l’underground, le marginal ?
La question revenant fréquemment, j’en suis finalement venu à convenir que ça doit me venir de mon enfance. Je suis né à Paris, puis j’ai ensuite vécu à Rome, au Maroc, en Lybie, dans les Cévennes, avec des séjours prolongés en Inde et en Égypte. En changeant d’école régulièrement, je me suis souvent trouvé dans la peau du nouveau, de l’étranger qui débarque dans une classe en cours d’année. Ce qui m’obligeait à m’adapter à des milieux souvent différents et à intégrer de facto très 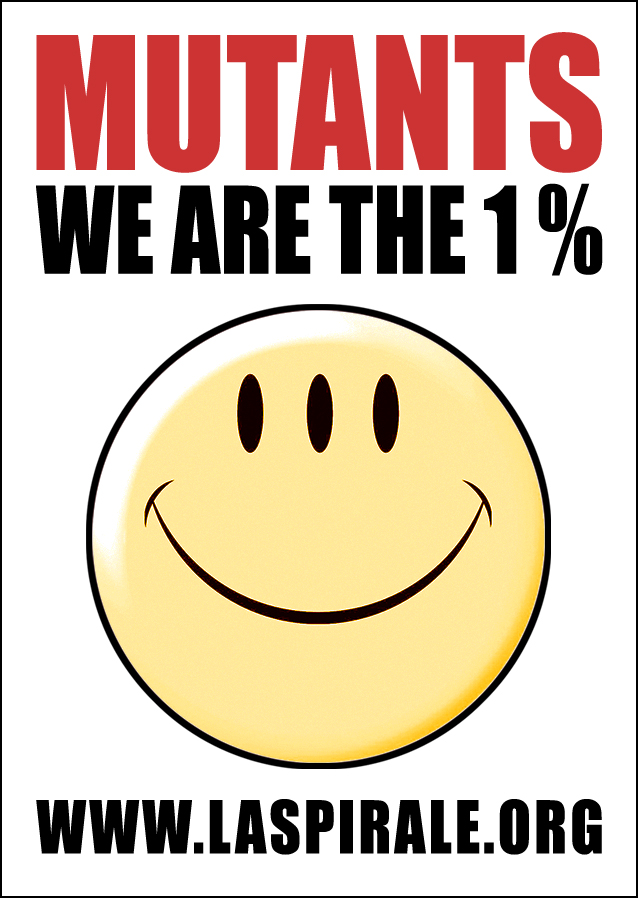 jeune une certaine forme de marginalité. Et puis, séjourner gamin dans des pays comme la Lybie te donne une vision particulière du monde. Là-bas, il m’était impossible de sortir à pied de la maison où nous vivions à Benghazi. Des bandes de chiens sauvages attaquaient les piétons dans notre quartier, l’armée faisait des descentes en jeep pour leur tirer dessus au fusil-mitrailleur après le coucher du soleil et la nuit, on se réveillait au gré des rafales. Je croisais régulièrement des camions débâchés de prisonniers aux yeux bandés, le matin en allant à l’école. Pour aller à la plage, il nous fallait montrer nos passeports. Il y avait une plage pour chaque nationalité de coopérants. Si tes copains étaient anglais ou suédois, tu ne pouvais les saluer qu’à travers les barbelés. Et ensuite, je pourrais te raconter les charters de gamines de mon âge, achetées sur catalogue et importées depuis le Caire, ou les rituels de transe auxquels j’ai assisté dans certains villages de la darb al-araba’în, la piste qui traverse le désert. C’était quand même assez sauvage…
jeune une certaine forme de marginalité. Et puis, séjourner gamin dans des pays comme la Lybie te donne une vision particulière du monde. Là-bas, il m’était impossible de sortir à pied de la maison où nous vivions à Benghazi. Des bandes de chiens sauvages attaquaient les piétons dans notre quartier, l’armée faisait des descentes en jeep pour leur tirer dessus au fusil-mitrailleur après le coucher du soleil et la nuit, on se réveillait au gré des rafales. Je croisais régulièrement des camions débâchés de prisonniers aux yeux bandés, le matin en allant à l’école. Pour aller à la plage, il nous fallait montrer nos passeports. Il y avait une plage pour chaque nationalité de coopérants. Si tes copains étaient anglais ou suédois, tu ne pouvais les saluer qu’à travers les barbelés. Et ensuite, je pourrais te raconter les charters de gamines de mon âge, achetées sur catalogue et importées depuis le Caire, ou les rituels de transe auxquels j’ai assisté dans certains villages de la darb al-araba’în, la piste qui traverse le désert. C’était quand même assez sauvage…
Après ces expériences enrichissantes en Lybie, puis d’autres en Inde, je me suis tout de suite reconnu dans les premiers punks que j’ai croisés en entrant au collège. Le premier disque que j’ai acheté à onze ans était Nevermind the Bollocks des Sex Pistols. J’adorais leur énergie, la fureur de Johnny Rotten. Derrière, il y a tout de suite eu le Black Album des Damned, puis le premier volume des  Greatest Hits des Cockney Rejects. J’ai rongé mon frein et dépensé tout mon argent de poche en achetant des disques chez New Rose, le magasin de disque punk-rock de l’époque à Paris, jusqu’à ce que je puisse m’investir concrètement dans la scène alternative. L’époque était très riche. Nous découvrions chaque semaine de nouveaux sons, de nouveaux styles de musique. Le hardcore US est arrivé en Europe, puis un nouveau genre de hip hop avec Public Enemy. Et là, je me suis vraiment reconnu dans leurs rages, dans l’énergie constructive développée par ces mouvances. Après, il y a eu la new beat belge et la house music, puis la techno, les premières raves au collège arménien et ensuite au fort de Champigny, les sound-systems reggae, dub et raggamuffin sur les péniches des quais de Seine. J’ai découvert William Gibson, le cyberpunk et enfin la cyberculture, au moment-même où la micro-informatique créative se démocratisait avec les premiers Mac et les Amiga 2000. La Spirale n’allait pas tarder à suivre avec sa première version papier en 1992, suivie de sa mise en ligne sur Internet en 1996.
Greatest Hits des Cockney Rejects. J’ai rongé mon frein et dépensé tout mon argent de poche en achetant des disques chez New Rose, le magasin de disque punk-rock de l’époque à Paris, jusqu’à ce que je puisse m’investir concrètement dans la scène alternative. L’époque était très riche. Nous découvrions chaque semaine de nouveaux sons, de nouveaux styles de musique. Le hardcore US est arrivé en Europe, puis un nouveau genre de hip hop avec Public Enemy. Et là, je me suis vraiment reconnu dans leurs rages, dans l’énergie constructive développée par ces mouvances. Après, il y a eu la new beat belge et la house music, puis la techno, les premières raves au collège arménien et ensuite au fort de Champigny, les sound-systems reggae, dub et raggamuffin sur les péniches des quais de Seine. J’ai découvert William Gibson, le cyberpunk et enfin la cyberculture, au moment-même où la micro-informatique créative se démocratisait avec les premiers Mac et les Amiga 2000. La Spirale n’allait pas tarder à suivre avec sa première version papier en 1992, suivie de sa mise en ligne sur Internet en 1996.
Je ne me souviens pas d’avoir jamais ressenti le moindre doute. C’était là que ça se passait, dans l’underground. C’était là que le présent et surtout l’avenir se dessinaient, certainement pas sur les bancs de l’université où je ne mettais jamais les pieds. Il suffisait d’ouvrir les oreilles et les yeux. C’était vraiment comme une sorte de grand mouvement perpétuel, sur lequel il est tout à fait possible de surfer intelligemment sans se brûler les ailes, quoi qu’en disent certains mythes rock ‘n’ roll. Contrairement à nos aînés des années 70 et du début des années 80, ma génération a rapidement tourné le dos à l’auto-destruction, à la violence urbaine et aux drogues dures. Le monde s’ouvrait plus encore, de nouveaux moyens de communication faisaient leur apparition. Disons que j’ai eu la chance de tomber au bon endroit et au bon moment !
Où tracer la ligne entre la « curiosité malsaine », le voyeurisme, et un intérêt légitime pour certains groupes hors-normes ?
Je ne me pose pas la question en termes de voyeurisme ou d’intérêt légitime. Tous les sujets sont bons à traiter, c’est plus le point de vue et l’intention du narrateur qui donnent le ton. On peut écrire et filmer de manière intéressante les sujets les plus dérangeants. Ou à l’inverse, rapporter de façon malsaine les plus belles choses. Tout se passe dans le regard de l’observateur et le reflet qu’il transmet par la suite.
Pour ce que j’en sais, nos lecteurs perçoivent La Spirale comme lumineuse, quels que soient les recoins ou les personnages obscurs sur lesquels elle s’attarde.
Avez-vous déjà refusé ou renoncé à une interview avec le sentiment d’être allé trop loin, soit par l’interview d’une personne dangereuse ou franchement ignoble comme, par exemple, Vice et le cannibale Issei Sagawa ?
Ma réponse est d’autant plus négative qu’il est de notoriété publique que j’ai interviewé un cannibale, lui-même en relation avec Issei Sagawa. Et que cet entretien était parfaitement cohérent dans le cadre de mon travail sur les vampyres. Même s’il s’agissait d’une forme de contre-point, il était important de l’intégrer.
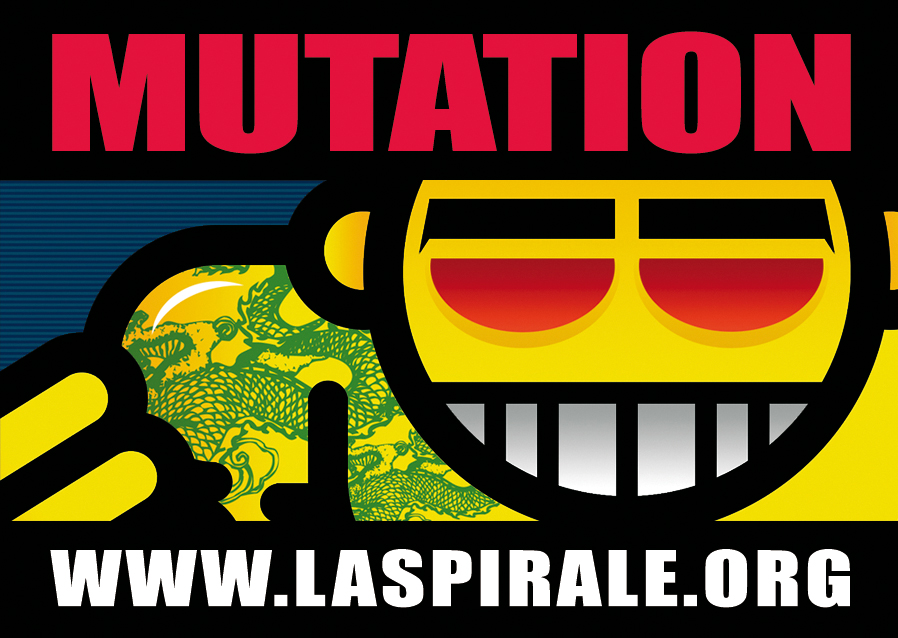 La manière dont je pratique le journalisme ne se borne pas à interviewer des gens dont je partage les opinions. Que mes positions politiques ou philosophiques soient différentes de celles des personnes que je rencontre n’interfère en rien. Je ne suis pas militant d’une cause ou en train de faire du prosélytisme. J’essaie juste de comprendre mon époque, ce qui n’est pas une mince affaire. (sourire) Et puis, les mouvements culturels les plus intéressants sont généralement issus de zones qui sentent le soufre. C’était le cas du punk originel, né dans les quartiers les plus mal famés du New York des 70’s, du hip hop quelques années plus tard sur les terrains de sport défoncés du Bronx, de la techno d’abord dans les ghettos de Détroit, puis sur la périphérie londonienne à la fin des années 80, du reggae en Jamaïque, etc. Dans ces quartiers, il y a bien sûr de la pauvreté et de la souffrance, des drogues souvent dures et des gens qui pensent mal, qui croient en des choses étranges ou qui pratiquent des cultes bizarres. Mais aussi un dynamisme qui donne parfois naissance à des initiatives fortes, véritablement créatives.
La manière dont je pratique le journalisme ne se borne pas à interviewer des gens dont je partage les opinions. Que mes positions politiques ou philosophiques soient différentes de celles des personnes que je rencontre n’interfère en rien. Je ne suis pas militant d’une cause ou en train de faire du prosélytisme. J’essaie juste de comprendre mon époque, ce qui n’est pas une mince affaire. (sourire) Et puis, les mouvements culturels les plus intéressants sont généralement issus de zones qui sentent le soufre. C’était le cas du punk originel, né dans les quartiers les plus mal famés du New York des 70’s, du hip hop quelques années plus tard sur les terrains de sport défoncés du Bronx, de la techno d’abord dans les ghettos de Détroit, puis sur la périphérie londonienne à la fin des années 80, du reggae en Jamaïque, etc. Dans ces quartiers, il y a bien sûr de la pauvreté et de la souffrance, des drogues souvent dures et des gens qui pensent mal, qui croient en des choses étranges ou qui pratiquent des cultes bizarres. Mais aussi un dynamisme qui donne parfois naissance à des initiatives fortes, véritablement créatives.
J’aimerais que les universités occidentales, que nos centres d’art subventionnés ou que les structures culturelles reconnues constituent des viviers comparables, mais rien ne semble indiquer que ce soit le cas. Il me semble donc que nous allons encore avoir besoin de l’underground pendant un bout de temps.
Dans ces marges, quelle est votre relation avec la maladie mentale… Est-ce un sujet ? Comment la traiter sans le cynisme sensationnaliste d’un Vice et la bienveillance hallucinée de certains autres magazines conspirationistes ?
Maladie mentale ? Je ne sais pas trop ce que je pourrais répondre sur ce sujet. Ca me semble très subjectif. La France se situe au deuxième rang des pays européens consommateurs d’anxiolytiques et d’hypnotiques. La consommation de ces médicaments y serait cinq fois plus grande que dans le reste des pays européens. Est-ce que les « marges » sont directement liées à ces chiffres ? Pour ma part, j’aurais plutôt tendance à croire que certains facteurs anxiogènes, liés à la crise de civilisation que l’Occident traverse, nous conduisent droit vers ce que l’on pourrait qualifier de « pandémie psychiatrique ». Et il faudrait aussi redéfinir ces « marges », souvent des antichambres ou des soupapes de respiration du système, plus de réelles alternatives.
Il m’arrive de jeter un oeil sur Vice. J’apprécie notamment leur rubrique Figthland, consacrée aux arts martiaux et aux sports de combat. Et il m’arrive de suivre Alex Jones ou David Icke que je trouve très amusants. Bien que je ne pense pas que l’on puisse expliquer de manière aussi simple que le font les conspirationnistes ce qui ne fonctionne pas sur notre planète, en rejetant perpétuellement la faute sur un ennemi réel ou imaginaire. C’est la raison pour laquelle j’essaie de plus en plus de focaliser La Spirale sur les initiatives qui apportent des débuts de solutions. Les médias de masse et les extrêmes politiques consacrent déjà assez d’énergie à nous tirer vers le bas.
N’est-ce pas trop dur d’écrire en français ? Nonobstant la restriction que cela représente en terme de public, les français s’intéressent-ils vraiment aux thématiques de La Spirale, notamment l’occultisme ?
Évidemment, le destin de La Spirale aurait été très différent si j’avais lancé le site à la même époque depuis la Californie ou, plus simplement, si nous publions en langue anglaise. J’envisage de revenir prochainement à une version entièrement bilingue, ce qui demande d’importants moyens financiers. C’est actuellement à l’étude. À la fois pour toucher un public plus large, puisque l’anglais fait dorénavant office de langue internationale, comme le bas latin dans l’empire romain, et pour accélérer nos échanges avec le monde entier.
Mais ça n’empêche pas les lecteurs du site de se compter chaque mois par dizaines de milliers, des chiffres en augmentation, ce qui indique qu’il existe bien un public en France pour les sujets parfois bizarres que La Spirale se fait une joie de traiter.
Êtes-vous un journaliste ? On a l’impression que vous êtes passé d’observateur des contre-cultures à acteur et même réalisateur, notamment par vos activités à la Demeure du Chaos où vous tournez votre nouveau film : Les Sources Occultes. Vous passez du documentaire, avec Vampyres à une oeuvre qu’on devine plus fictionnelle et plus… engagée.
Oui, on peut dire que je pratique une forme de journalisme, bien que je ne me sois jamais trouvé en possession d’une carte de presse. À la base, le journalisme fut un accident, un peu comme tout le reste. Je publiais un fanzine en ligne, sans attentes professionnelles dans ce domaine, lorsque Le Monde m’a contacté pour participer à leur supplément Interactif consacré aux nouvelles technologies et à la culture numérique. Par la suite, il m’est arrivé d’écrire pour Libération et d’autres titres, mais il s’agissait plus d’une parenthèse instructive qui m’a permis d’observer le fonctionnement des médias de l’intérieur. Au final, je suis plus à l’aise lorsque j’écris en toute indépendance pour La Spirale, pdans le cadre des publications de la Demeure du Chaos ou dans une collaboration libre, comme c’est le cas avec Chro.
Pour ce qui est des Sources Occultes, il s’agit en effet d’un film de fiction. Un film fantastique et d’horreur, peuplé de monstres et de créatures. Est-ce qu’il est engagé ? Pour moi, une oeuvre se devrait d’être « mutante », évolutive et en prise avec son époque. Mais ce n’est pas à moi de considérer qu’il s’agit ici d’une « oeuvre » et j’avoue aussi ne pas m’être posé la question en terme d’engagement, pas plus que de me préoccuper donc de savoir si ce que je fais est « artistique ». Il faut déjà faire. On verra après. (sourire) Mais tu as peut-être raison au sujet de l’engagement, puisqu’il traite de transcendance, de survie en milieu hostile et de la fin d’un monde. Et puis, le fait qu’il s’inscrive dans la Demeure du Chaos n’a (évidemment) rien d’anodin. Après, nous sommes encore en pleine production et je préfère ne pas trop m’étendre sur le sujet. Reparlons-en, si tu le veux bien, après la sortie du film et de la web-série qui précédera le long-métrage.
Dans ce cas, La Spirale est-elle un travail sur l’art de vivre – ou l’art de survivre – dans un monde déliquescent ? Un « manuel de survie » sur le modèle du superbe MUST-READ Manuel de Survie à l’usage de l’étudiant des religions du futur de Rémi Sussan ?
Julien Millanvoye avait écrit dans le magazine Blast en 2004 qu’il se révélait urgent d’ouvrir Mutations pop et crash culture pour avoir une idée des « solutions que nous apportent l’imagination et la vie ». Un des plus beaux compliments que l’on m’ait fait ; ton idée d’un travail sur l’« art de vivre » m’en semble assez proche. Ca me plaît beaucoup. Oui, un travail sur les différentes manières de vivre, d’agir et d’avancer en ce début de XXIe siècle qui fait tourner les têtes. L’ère de l’accélération et de l’accident, comme l’a écrit Paul Virilio.
A contrario des oiseaux de mauvais augure, particulièrement nombreux durant ces dernières années, je reste résolument optimiste et volontariste. Nous pouvons à tout moment changer de direction et de mode de vie, d’un point de vue personnel ou global. L’avenir est toujours entre nos mains. Aujourd’hui, certains veulent croire que nous sommes au creux de la vague. Et c’est précisément dans ces moments que l’être humain se révèle sous son meilleur jour. Adopter une posture nihiliste, c’est choisir la voie de la fainéantise et de la facilité. Le monde peut et doit être entendu comme un infini de possibles.
Ce que nous racontaient les écrivains de science-fiction du siècle dernier prend forme sous nos yeux. Google vient de racheter la firme Boston Dynamics, à la pointe de la robotique. Des cliniques d’extrême longévité ouvrent un peu partout dans le monde, certes pour les classes les plus aisées. Mais la Silicon Valley s’investit aussi lourdement dans le domaine des énergies renouvelables. Les drones civils envahissent nos ciels. Il ne se passe plus une semaine sans une découverte scientifique ou médicale d’importance. Et d’un autre côté, la pyramide des richesses n’a jamais été aussi inégalitaire, doublée d’une explosion de la fécondité dans les pays pauvres.
Les enjeux sont énormes. Nous vivons une époque formidable et peut-être pas si déliquescente, après tout.
Des conseils de survie, là tout de suite ?
Action ! (sourire) Arrêtez de vous regarder le nombril et avancez. Concentrez-vous sur ce que vous allez faire, sur ce que sera votre prochain mouvement. Partagez vos connaissances et vos compétences, communiquez sur autre chose que vous-même et libérez-vous de ce foutu narcissisme ambiant, qui gangrène notre société. Aujourd’hui, comme hier et demain, le maître-mot reste l’auto-production.
L’écrivain de science-fiction Norman Spinrad a parfaitement résumé les enjeux de notre époque dans un texte définitif, intitulé La Crise de transformation. Je le cite… « Nous vivons actuellement la période la plus critique de l’histoire de l’humanité, le stade le plus critique, en fait, de l’évolution de la vie sur Terre. Une crise d’évolution parvenue à éclosion dans le ciel d’Hiroshima en 1945, qui se poursuivra sans doute jusqu’au coeur du XXle siècle, si nous ne nous détruisons pas nous-mêmes, après avoir d’abord détruit la biosphère terrestre. (…) Nous sommes les générations de la Crise de Transformation. Faisons le travail comme il faut, ou bien nous n’en aurons plus aucun à faire. »
Il n’y a pas grand-chose à ajouter à cet extrait. À chacun d’entre nous de choisir son camp et de savoir s’il veut faire partie du problème ou de la solution. Si nous le choisissons, nous pouvons sans aucun doute nous trouver aux balbutiements d’une nouvelle civilisation, plutôt qu’au crépuscule d’une humanité dépassée et moribonde.
Pour ma part, j’ai envie d’y croire. D’autant que la vie m’apparaît autrement souriante, drôle et excitante dans cette perspective…










